Bazin, critique de télévision
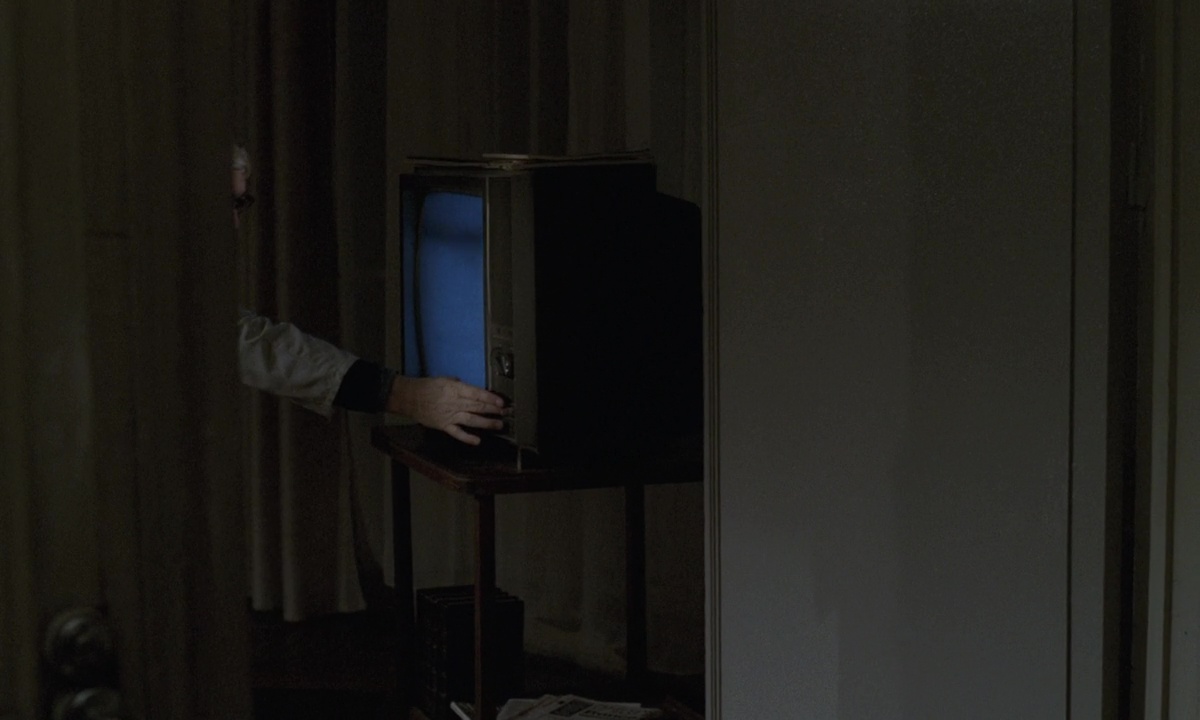
Pour François Truffaut, André Bazin (1918-1958), qu’il qualifiait d’« écrivain de cinéma »1 , fut l’homme qui s’était soucié de son sort. Nul ne peut sous-estimer l’influence et l’héritage de Bazin. Des générations de critiques de cinéma et d’auteurs de films, plus particulièrement ceux apparentés à la nouvelle vague, sont redevables à ses écrits sur le cinéma. Auteur de plus de deux mille textes, Bazin aura donné une orientation complètement novatrice au cinéma en tant que forme artistique. Pour Jean-Luc Godard, il fut un « auteur de films qui ne faisait pas de films, mais qui, tel un colporteur, faisait du cinéma parce qu’il en parlait. »
Bazin a fait de la critique une occupation publique et quotidienne. Dans l’après-guerre il s’engage dans la plupart des magazines ayant un lien quelconque avec les débuts de la culture cinématographique. Cet engagement atteint son apogée lorsqu’il fonde Les cahiers du cinéma en 1951 avec Jacques Doniol-Valcroze et Joseph-Marie Lo Duca. Quelques années auparavant, il avait contribué à l’organisation de l’illustre Festival du Film Maudit à Biarritz, où il rencontra quelques-uns de ses futurs collaborateurs des Cahiers et les cinéastes de ce qui deviendrait la Nouvelle Vague. C’est aussi à cette époque que son état de santé, déjà fragile, se dégrade au point de devenir critique et qu’il se retrouve cloué au lit. C’est entre autres pour cette raison qu’il s’orientera vers la télévision. Il estime que le petit écran occupe une partie importante dans le monde de l’image dont il veut être le descripteur. La télévision offre une expérience visuelle différente et un rapport nouveau à la réalité qu’elle décrit. Le paysage télévisuel français ne couvre alors qu’un territoire très restreint. Il n’y a qu’une seule chaîne, le temps d’antenne quotidien est réduit et l’offre de programmes limitée, ce qui permet à Bazin de suivre de près les débuts de la télévision et de les répertorier. Bazin avait certes des préférences prononcées, tant en ce qui concerne la programmation que pour la petite élite des personnalités de la télévision. Les inexactitudes factuelles dans les programmes scientifiques le contrariaient d’ailleurs outre-mesure, surtout lorsqu’il s’agissait d’animaux.2
Le réalisme est le point de repère fondamental pour Bazin, son guide lors du visionnage de films, un terme qu’il utilise toujours avec une certaine circonspection : « Ce qu’on nomme couramment réalisme n’a pas tant de sens absolu et clair qu’il désigne, mais c’est plutôt un mouvement, une tendance vers le rendu fidèle de la réalité. »3 Le réalisme ne relève donc pas, selon Bazin, d’une philosophie cohérente, mais il s’agit plutôt d’un geste de l’auteur du film envers le monde tel qu’il le perçoit, doublé d’une façon d’observer les choses. Dans « Ontologie de l’image photographique », son texte sans doute le plus réputé et commenté, datant de 1945, Bazin décrit, comme indiqué précédemment, l’essence de l’image photographique et son aptitude à créer un transfert de réalité, « une fenêtre sur le monde. » L’image photographique, et l’image cinématographique par extension, peut révéler le réel : « Ce reflet dans le trottoir mouillé, ce geste d’un enfant, il ne dépendait pas de moi de les distinguer dans le tissu du monde extérieur ; seule l’impassibilité de l’objectif, en dépouillant l’objet des habitudes et des préjugés, de toute la crasse spirituelle dont l’enrobait ma perception, pouvait le rendre vierge à mon attention et partant à mon amour. »4 La façon de faire du cinéma incite l’auteur de films à vouloir se rapprocher de la réalité ; dans « L’évolution du langage cinématographique », un autre de ses textes importants, Bazin nomme cette démarche « agir selon une croyance en la réalité ». Le spectateur ressent cette réalité à son tour comme étant « plus proche ». Le cinéma crée une interface intime entre eux. Bazin aimait le cinéma de Renoir parce qu’il n’exclut pas la vie qui se manifeste devant l’objectif, mais qu’il en garde quelque chose et qu’il a en même temps la volonté de le retenir.
La pensée de Bazin sur la télévision relève d’une autre approche. Eveillé par les nombreuses possibilités que celle-ci offre, il est néanmoins tout à fait conscient des nombreux écueils de ce nouveau medium, ce qui l’incite à une certaine prudence dans ses descriptions. Il craint les grandes considérations théoriques, sa démarche est quelquefois sévère, son regard sur ce nouveau phénomène plutôt méfiant ; pourtant il lui arrive, à d’autres occasions, d’avoir une approche assez enjouée. Contrairement au cinéma, la réalité « s’introduit » dans le salon par une surface bien plus réduite. Les rayons lumineux de cet écran carré ont une intimité et une présence différentes. Dans un article Bazin compare la lumière du projecteur du grand écran au faisceau lumineux de la lune qui nous illumine indirectement et « qui ne porte en lui qu’ombre et illusions fugitives ».5 L’obscurité enveloppante du cinéma, qui permet à ce « cône dansant »6 – ainsi le désignait Roland Barthes – de se frayer un chemin, fait défaut, car la transmission télévisuelle est plus directe. Dans le texte « L’avenir esthétique de la télévision »7 un des textes recueillis dans ce dossier, Bazin pointe avec justesse la différence de la distance ressentie par rapport à l’image. Il y cite l’exemple presque banal d’une rencontre dans la rue avec une personne qu’il croit reconnaître vaguement. La main déjà tendue, il se rend compte que c’est quelqu’un qu’il a « rencontré » la veille dans son salon, un interlocuteur de l’autre côté. Ailleurs Bazin décrit la détresse d’un acteur lorsqu’il joue une pièce de théâtre pour la télévision : cet acteur a un moment d’hésitation, il a oublié son texte. Au théâtre l’acteur peut compter sur la sympathie du public présent, alors que devant une caméra en direct il est bien plus vulnérable. L’acteur éprouve une solitude extrême, alors qu’un nombre incalculable d’yeux invisibles sont rivés sur lui. Le moindre accroc résonne dans une multitude infinie d’intérieurs.
A la télévision, l’image en direct par excellence crée une autre interface avec la réalité. Dans « Ontologie de l’image photographique » Bazin se sert entre autres de la métaphore du masque mortuaire pour expliquer que l’image cinématographique retient une part de la réalité exposée. La relation entre les deux est d’ordre indexal, comme la fumée réfère au feu ou comme une « empreinte ». Ce qui est retenu au cinéma appartient irrémédiablement au passé ; l’image « embaume le temps », comme « l’ambre immobilisait le corps intact des insectes d’une ère révolue »8 . La force du direct à la télévision réside, d’après Bazin, dans la simultanéité du visionnage et de l’événement. « La télévision fait apparaître une notion nouvelle de présence, pure de tout contenu humain visible (et qui ne serait en somme que la présence du spectacle lui-même). Un travelling de télévision ne passe jamais deux fois par le même endroit. Il n’y a pas plus de cadrages identiques que de feuilles d’arbres superposables. Aimons l’image que jamais nous ne verrons deux fois. »9 La défaillance de l’acteur ne se reproduit jamais. Le direct à la télévision introduit un facteur de risque ; le hasard peut jouer un rôle. Bazin donne l’exemple de la lune portée à l’écran pendant une émission en direct. Il n’y a que peu de différence en soi entre cette image spécifique et « une transmission photographique », mais l’assurance que cette même lune est perçue au même instant par la fenêtre suffit à changer la qualité de l’image. « Rien que la Lune mais, si j’ose dire : vivante ! »10 Cet exemple illustre clairement que la télévision est en grande partie un prolongement des désirs humains. Le désir d’ubiquité et d’être le témoin de tout ce qui se passe, et même de préférence dans le confort du chez soi. Il ne faudra pas plus de dix ans après ses propos pour que la télévision et le premier homme marchent conjointement sur la lune.
La télévision nous « rapprocherait » également « de l’être humain », dit un slogan maintes fois cité. « On ne fera jamais au cinéma la biographie de ma concierge ou de mon épicier : elles peuvent être admirables et bouleversantes sur l’écran de mon poste. »11
Aux yeux de Bazin, la télévision possède une « intimité quotidienne avec la vie »12
, chaque jour elle invite le monde dans notre salon pour s’intégrer à notre propre vie intime et l’enrichir. Dès ses débuts, la dimension humaine y occupe une place centrale et on accorde de l’importance à l’intérêt humain. De nos jours, ces valeurs restent déterminantes pour bien des réalisations. « Chaque fois qu’un être humain qui mérite d'être connu entre dans le champ de l'iconoscope, l'image se fait plus dense et quelque chose de cet homme nous est donné. »13
Ce mérite n’a rien à voir avec la beauté ou l’intelligence, prétend Bazin, qui propose le terme de télégénie, mais avec une certaine authenticité et dignité humaines dégagées par l’image. Cette révélation de l’humain comporte également un aspect moral : « La télévision est peut-être de ce point de vue le medium le plus moral de tous les arts mécaniques » écrit Bazin à propos d’un programme de Jean Thévenot. « Mais [Thévenot] démontre maintenant en s’adressant à des ‘ Français moyens’, que les rois et les bergers, les génies et les esprits simples sont égaux devant la télévision, de la même façon que nous le sommes tous devant la mort. »14
Sous cet aspect, la télévision permettrait une nouvelle forme de langage et donnerait une voix à ceux qui n’en ont point. Il s’agit d’une promesse étroitement liée à l’humanisme qui inspira la croyance en la télévision, la conviction que la télévision peut également être formatrice au niveau socio-culturel et qu’elle possède un potentiel didactique, l’idée à la base par exemple des films historiques pour la télé de Roberto Rossellini.15

Son omniprésence, l’idéal démocratique de l’information disponible, la diffusion de la culture et l’aspect moral de la télévision : tout ce qui témoignait de son potentiel en tant que médium s’est ensuite avéré utopique. Après la phase de recherche et de développement « expérimental », beaucoup perdirent rapidement leur croyance vacillante en ce nouveau médium. Pour bien des critiques la fascination se transforma en répulsion à cause du caractère manipulateur que cachait ce flux croissant d’images. Theodor Adorno16 , qui place la télévision au sein de sa critique élargie de l’industrie culturelle, qualifie très tôt la télévision de « rêve sans rêve, […] un moyen de s’approcher du but de reposséder le monde sensible tout entier, sous forme d’une copie satisfaisant tout organe sensoriel. » Pour Adorno, le monde que la télévision nous dévoile est un duplicata vide et ce qu’elle nous apporte est d’ordre « idéologique ». Une bonne trentaine d’années plus tard, Pierre Bourdieu tire une conclusion similaire dans son analyse approfondie Sur la télévision (1998), cette fois sous un angle sociologique : « Et, de fil en aiguille, la télévision qui prétend être un instrument d’enregistrement, devient un instrument de création de réalité. On va de plus en plus vers des univers où le monde social est décrit-prescrit par la télévision. »17 Lui-même zappeur18 actif à une période de sa vie, Serge Daney dresse, de son point de vue de critique cinématographique, un bilan de ces idées maîtresses utopiques sur le reportage en direct de la Guerre du Golfe dans l’essai « Montage obligé. La guerre, le Golf et le petit écran. »19 L’omniprésence du visuel cache un vide obscène. « La télé est regardée parce qu'elle est tout ce qu’il y a de réaliste. Elle dit vrai et elle informe absolument. »20 , prétend Daney. Seulement, cette vérité est unilatérale ; la télévision relate l’opinion du pouvoir. Dans le flux incessant d’images, l’horreur de la Guerre du Golfe se réduit à un événement porté par les seules images, une réalité représentée où toute contre-image fait défaut, sous forme d’une « obscénité inutile ».21 Les images de la guerre ne servent plus qu’à draper la victoire américaine. Daney distinguera en l’occurrence l’image et le matériel visuel. Contrairement au visuel, l’image est toujours « plus et moins qu’elle-même », il manquera toujours quelque chose. Ce manque permet l’accès à autre chose : une contre-image. Il exerce une certaine résistance.
Chez Bazin le spectacle de l’émission en direct possède du moins un certain charme. Dans un de ses commentaires, il raconte par exemple qu’il a « l’impression d’être invité » à une soirée parisienne diffusée en direct, à laquelle Chaplin est également convié. Sous la plume de Daney, le « discret brouhaha du son direct »22 se teinte d’une fâcheuse connotation et le téléspectateur devient complice d’un spectacle ayant perdu toute son innocence. Dans le spectacle visuel de la Guerre du Golfe, la télévision manifeste à la fois une sensibilité formelle erronée et son caractère mécanique. A l’époque de Bazin, cette mécanique s’emballait encore régulièrement et il y avait des moments où l’évènement télévisuel s’égarait un peu et où le rythme flanchait. A l’arrière-plan du spectacle, apparaissait de temps en temps, – souvent en marge de l’image –, quelque chose de sincère et d’authentique. Par exemple la présence d’une femme qui distribuait les prix. Tapie dans un coin, elle attendait le moment précis pour remettre un bouquet de fleurs. Jamais, la caméra ne la cadrerait délibérément, écrit Bazin, mais sa présence sur le plateau était dévoilée sous forme de flashs, au grand bonheur du critique. Daney aussi sait que la marge du cadre visuel est importante, il lui semble qu’elle représente le seul espace résiduel pour l’expression politique. Même s’il s’agit ici des regards outrés des passants dans les rues de Bagdad que l’on voit en arrière-plan. Eux seuls semblent préserver péniblement l’engagement politique de l’idéal « démocratique » de l’information, la seule chose qui résiste encore au point de vue du pouvoir. « Qui me dit que cet air et ce regard-là ne sont pas le noyau dur sans lequel il n'y aurait que des signes à « lire » et plus d'hommes à « voir » ?23
La télévision est devenue un médium qui manque de finition, elle souffre du manque d’imagination ordonnée. En 1976, bien avant l’impact médiatique de la première Guerre du Golfe (1990-1991), Dirk Lauwaert avait déjà écrit que la télévision est « toujours en devenir », qu’elle se situe toujours dans le présent. A chaque fois, c’est le spectateur qui élabore la « finition », grâce à son regard il participe « à sa création, il en fait partie et est complice du produit fini.24 Le “massif”, voilà le nom que Lauwaert donne à cette obscénité inutile. Le massif, c’est « comme une tumeur cancéreuse de la conviction, de la perspective, de la solidarité. Impossible désormais de situer le massif (‘je le suis pour telle raison’), car il devient la pièce centrale à partir de laquelle tout se situe. » Il n’est pas aisé d’échapper à la complicité que la télévision nous impose. « Face au collaborateur il y a l’inadapté, le marginal, le déviant. » Cela suppose une approche critique des images, ce que Daney considérait déjà comme « un flirt avec l’impossible ».25 Ceci exige un « regard de biais », qui recherche incessamment les images manquantes, tentant de détecter ce que la télévision refuse de montrer et tâchant de combler le manque d’imagination. A ce stade, Lauwaert clôt son texte sur une note pessimiste : « Nulle autre approche n’existe, ni une meilleure ou une ‘plus riche’, parce qu’il faut faire face à tant de matière humaine, technique, bureaucratique. » La télévision fait désormais partie intégrante de notre vie et incarne l’inertie et l’immobilité, elle nous « désarme ».26
Le critique de télévision lutte contre quelque chose qui est en perpétuel mouvement et sur lequel il a de moins en moins prise. Ecrire sur la télévision devient paradoxal : « Pour comprendre la télévision il faut un certain recul, un recul que je n’ai pas, que personne d’ailleurs ne possède ». Voilà ce que dit Daney dans un de ses derniers interviews.27 Pour celui qui ose s’y coller, il reste la « gymnastique épuisante » du regard, de « ne jamais être là où la télévision nous attend » et d’imaginer ce que l’on ne voit plus. »28
Ce recul critique auquel Daney fait allusion est d’autant plus illusoire de nos jours. « Auparavant, les images étaient dans le monde. Aujourd’hui, c’est le monde qui baigne dans un océan d’images. » Voilà les premiers mots de State of Cinema de Nicole Brenez pour Sabzian en 2021. Bazin a décrit le moment où la télévision avait introduit des images dans sa vie pour la première fois et le potentiel que cela recelait. En même temps, il a aperçu la première lueur d’un autre monde qui déjà semblait s’annoncer. Pour Dirk Lauwaert, « la critique est une lucidité désespérément noyée dans la naïveté ».29
Conscient de son regard d’explorateur, Bazin est resté lucide dans tous ses écrits, jamais il ne fut naïf. Si ses écrits sur la télévision peuvent nous servir de guide, ce sera sans doute vers une approche différente de notre vie avec les images. Ils nous permettront, ne fût-ce qu’un instant, de toucher « l’impossible » du bout des doigts.
- 1Cf. l’introduction de Truffaut dans le livre de Bazin sur Jean Renoir.
- 2Grand ami des animaux, Bazin était aussi un géologue amateur. Il alla jusqu’à garder pendant des mois un alligator dans sa baignoire, au grand dam de son épouse.
- 3« Ce qu’on nomme couramment réalisme n’a pas tant de sens absolu et clair qu’il ne désigne plutôt un mouvement, une tendance vers le rendu fidèle de la réalité. » André Bazin, ‘Renoir français’, dans André Bazin. Écrits complets, Hervé Joubert-Laurencin réd., Macula, Paris, 2018, p. 841. Publication originale dans Cahiers du cinéma, n°8, janvier 1952).
- 4André Bazin, ‘Ontologie de l’image photographique’, dans André Bazin. Écrits complets, Hervé Joubert-Laurencin réd., Macula, Paris, 2018, pp. 108-111. Publication originale dans Les Problèmes de la peinture, G. Diehl réd., Éditions Confluences, Lyon, 1945, pp. 405-411.
- 5André Bazin, « Créer un public », dans : L’Information universitaire 1185, 18 mars 1944.
- 6Roland Barthes, « En sortant du cinéma », dans Communications 23, Seuil, Paris, 1975, p. 104. Dans ce même texte Barthes prétend que « nous sommes condamnés à la Famille » par la télévision, « dont elle est devenue l'instrument ménager, comme le fut autrefois l'âtre, flanqué de sa marmite commune ».
- 7André Bazin, « L’Avenir esthétique de la télévision : La T.V. est le plus humain des arts mécaniques’, dans : Réforme 548, 17 septembre 1955.
- 8André Bazin, « Ontologie de l’image photographique », pp 108-111.
- 9André Bazin, « Un reportage sur l’éternité : La visite au musée Rodin », dans Radio-Cinéma-Télévision 148, 16 novembre 1952.
- 10André Bazin, « La télévision moyen de culture », Sabzian, 11 décembre 2019.
- 11André Bazin, « A la Recherche de la télégénie », dans Radio-Cinéma-Télévision 270, 20 mars 1955.
- 12André Bazin, ‘L’Avenir esthétique de la télévision : La T.V. est le plus humain des arts mécaniques’, Réforme, 548, 17 septembre 1955.
- 13Ibid.
- 14Ibid.
- 15Luís Mendonça, ‘Rossellini en de strijd tegen onwetendheid op televisie’, Sabzian, 13 juin 2018, traduit du portugais “Rossellini o e combate à ignorância na televisão”, 2014, « Rossellini et le combat contre l’ignorance à la télévision ».
- 16Theodor W. Adorno, Modèles critiques. Interventions – Répliques (Paris : Payot, 1984): 55. Traduit de l’allemand par Marc Jimenez et Eliane Kaufholz.
- 17Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Editions Raisons d’agir, Paris, 1996, 22.
- 18Daney écrit entre septembre et décembre 1987 des articles sur la télévision pour le journal Libération. Ces textes furent rassemblés en un premier temps dans le recueil Le salaire du zappeur (Ramsay Poche Cinéma, 1988). En quatrième de couverture on lit : « Cent jours durant, un critique de cinéma, journaliste à Libération, a regardé six chaînes de la télévision française, et s’est baigné plutôt deux fois qu’une dans leurs fleuves d’images et de sons ». Ce qui le motivait ? Une « certaine perplexité » quant à l’état du cinéma – et de la critique de cinéma – et une réelle curiosité quant à celui de la télévision. Ces textes sont ceux d’un « frontalier » sans cesse en voyage entre « sa patrie d’origine (le cinéma) et ce continent étrangement peu connu et encore moins commenté qu’est la télévision. »
- 19Ce texte parut dans Devant la recrudescence des vols de sacs à main, cinéma, télévision, information (Lyon : Aleas éditeur, 1991)
- 20Ibid.
- 21Ibid.
- 22Serge Daney, « Zoom interdit », dans Ciné journal Volume II / 1983-1986 (Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 1998): 62.
- 23Dans un texte de 1996, « Fantasmes télévisuels », Jean Baudrillard, (déçu), adopte un ton similaire: « La véritable catastrophe de la télévision, c'est cette déception profonde quant à la fonction moderne de l'information. On a rêvé d'abord de l'imagination au pouvoir – au pouvoir politique s'entend – mais on en rêve de moins en moins, sinon plus du tout. »
- 24Dirk Lauwaert, « De zekerheden van het massieve », (Les certitudes du massif) dans : Film & Televisie 228-229, mai 1976. Disponible en anglais sur Sabzian.
- 25Serge Daney, « Montage obligé. La guerre, le Golfe et le petit écran ».
- 26Dirk Lauwaert, « De zekerheden van het massieve ».
- 27Regis Debray a interviewé Serge Daney en 1992, pour le programme Océaniques de la chaîne FR3, la transcription de l’interview filmé sera publié plus tard sous le titre « Itinéraire d’un ciné-fils ».
- 28« Reste alors à imaginer ce qu'on ne voit plus. L’imagination est le fantôme de l'image. » Serge Daney, « Montage obligé. La guerre, le Golfe et le petit écran ».
- 29Cité dans Rudi Laermans, ‘Dirk Lauwaert als criticus. Fragmenten voor een intellectuele biografie’, (Dirk Lauwaert, critique. Fragments pour une biographie intellectuelle), dans De Witte Raaf 192, mars-avril 2018.
Image (1) de À nos amours (Maurice Pialat, 1983)
Image (2) de Whatever Happened to Baby Jane? (Robert Aldrich, 1962)
Image (3) de Jackie Brown (Quentin Tarantino, 1997)

