Méandres
En juin 1994, le Festival international du film documentaire Vue sur les Docs, à Marseille, a organisé une rétrospective de mes films. Nous avons fait un vrai travail de présentation et d’information. Pour la clôture, j’ai participé, dans une ambiance chaleureuse, à un débat avec le public animé par Marie-Christine Perrière et Bernard Favier, qu’ici je remercie. J’ai eu ensuite le désir de retravailler cette parole pour en faire un texte, que j’appelle « Méandres », car il m’est familier d’avancer selon une trajectoire anguleuse, sinueuse, d’une chose à l’autre. Ce mouvement détermine souvent la forme de mes films : je tourne dans les coins, et je négocie les virages.

Donc : les cinéastes qui m’ont influencé sont autant des cinéastes de fiction que des documentaristes. À ce niveau, la différence n’a jamais joué. C’est le cinéma, simplement, qui m’intéressait. À une certaine époque, Hitchcock, par exemple. Dans certains de mes films, il y a un travail du champ-contre-champ, un des procédés classiques du cinéma narratif. II y a parfois une certaine froideur, par exemple dans Het masker [Le masque] (1989, 55 mn), qui peut rappeler Hitchcock. Je pense à certains plans de Marnie (1964), marqués par un statut d’incertitude : est-ce du réel ou du rêve ? Dans Le masque, il y a une scène où le personnage central, Philippe, un jeune SDF, se fait couper les cheveux chez le coiffeur, pour obtenir l’apparence bourgeoise tant désirée. Puis, dans le jeu de miroirs d’une boutique de mode, il enfile le costume qui doit lui servir de « masque » social. Des transformations s’effectuent sur son corps même, qui sont donc « vraies », mais qui sont démenties dans la scène suivante, où nous retrouvons Philippe dans le dortoir de l’Armée du Salut avec son physique de galérien. Cette ambiguïté, cette incertitude sur le comment de ces images, fait déraper, sortir des marques et des balises du documentaire.
Il y a le plaisir aussi, en faisant des films, d’arriver à m’étonner moi-même, à faire des films que, peut-être, je ne comprendrai que dix ans plus tard. Un petit film comme On Animal Locomotion (1994, 15 mn), par exemple, son intérêt, à mes yeux, est qu’il s’y dévoile quelque chose qui me surprend totalement. Mais la nécessité de son filmage, dans le détail, m’apparaît aussi : ça se tient, thématiquement, cela a une certaine force, même si les raisons de me filmer ainsi, tenant la caméra devant moi – des fragments de mon corps, mon visage bouffon –, sont irrationnelles. Il y a là un lien évident avec l’œuvre d’Eadweard Muybridge (Human and Animal Locomotion, 1887), ce photographe et précurseur du cinéma qui a analysé le mouvement du corps. En braquant la caméra sur moi, je deviens mon propre Muybridge. Mais, encore plus important : il me fallait un contre-mouvement aux images qui se précipitent sur moi, un contre-courant à tout ce qui vient de l’extérieur. L’intérieur, c’est la place du cinéaste, son œil, sa tête, et je dirais qu’il faut un intérieur à tout extérieur. Ce sont là les raisons visibles, repérables. Derrière elles sont les motifs plus intimes, qu’on n’entrevoit souvent que beaucoup plus tard.
Pour la soirée d’ouverture de ce festival, on avait prévu de montrer le Sarajevo Film Festival Film (1993, 14 mn). On m’a dit que ce petit film avait touché beaucoup de gens, qu’on y sentait, sans violence évidente ni images sanglantes, ce que cela pouvait être que de vivre en ces circonstances de siège et de guerre, mieux que dans des documents, en un sens, beaucoup plus forts. Dans ce cas-là, on peut dire que la réception du film s’est pour ainsi dire stabilisée, ce qui n’est pas toujours le cas. C’est ainsi qu’il faut présenter mes films, il faut qu’ils se renforcent et se déchirent entre eux. Il faut leur laisser un aspect inattendu, mystérieux, qu’ils soient vus en quelque sorte image par image. Par exemple, On Animal Locomotion, c’est un second film sur Sarajevo, dont la réception est complètement instable. Il s’agit toujours de déstabiliser la façon dont on voit les choses, afin de pouvoir atteindre, ne serait-ce qu’un instant, l’expérience.
J’ai été influencé, très jeune, par un photographe hollandais, Ed van der Elsken, dont le premier album, Een liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Prés [Un amour à Saint-Germain-des-Prés] (1954), est organisé en un faux récit : une sorte de bande photographique sur certains marginaux, soi-disant « existentialistes », à Paris, au début des années cinquante. Une photo très noire et très crue, très picturale en même temps. C’est un peu lui qui m’a découvert, quand il a vu les photos que j’avais faites depuis l’âge de quinze ans, il m’a encouragé, et pratiquement autorisé, à entreprendre et à publier mon premier livre d’images : Wij zijn 17 [Nous avons 17 ans] (1955). C’est là que j’ai entrevu un tout autre monde, une liberté hors de cet univers de classe moyenne dont j’étais originaire. J’ai dédié Face Value (1991, 120 mn) à ce photographe, et filmé son portrait, peu avant sa mort. Il dialogue avec sa femme, tandis qu’il est en train de mourir, formulant une sorte de religion à propos de la vie matérielle, que je trouve formidable : « Cette maladie, c’est mon chagrin privé, que j’essaierai de porter avec élégance, jusqu’à la fin. Tout se présente de façon totalement logique : on grandit, on s’épanouit, on se dégrade, et c’est tout. Mais la vie est si incroyable qu’elle comprend déjà son propre Paradis. Ces gens qui demandent : pourquoi est-on sur terre ? On est là pour profiter de la création, nom de Dieu ! Et si tu n’es pas capable de voir ça, t’es une belle ordure ! »
À mon arrivée à Paris, en 1956, j’ai fait la découverte d’un livre extraordinaire : le New York de William Klein (album Petite Planète n° 1, éditions du Seuil, 1956). En rentrant à l’IDHEC, je l’ai pris comme un vrai coup dans la gueule, quelque chose d’immense. Avec cette expression, ces formes-là, quelque chose des barrières culturelles paraissait se briser, ouvrait la voie à autre chose. Et puis, vers la fin de mes études à l’IDHEC, à vingt ans, en 1958, j’ai vu arriver certains films de la Nouvelle Vague. La longue course sur la plage, à la fin des Quatre cents coups (1959) de Truffaut, c’était peut-être la première fois que je voyais un film quitter résolument le contexte narratif pour s’installer dans la poésie d’une durée palpable : quel choc ! Encore plus fort, À bout de souffle (1960) de Godard : il avait coupé là où il voulait, au milieu des plans, composant son film comme une série de jump cuts. Il se permettait une liberté entièrement nouvelle. L’ère du travelling en fauteuil roulant commençait, avec l’impression que le cinéma se découvrait de nouveaux moyens, la permission de faire tout ce que l’IDHEC n’enseignait pas. À partir de là, à la mesure de mon travail photographique (avec un projet d’album sur Paris,1 je me baladais avec mon appareil-photo à la main), l’idée et le désir d’un cinéma totalement physique se sont mis à me hanter, pour un cinéma « direct ». Ensuite est venue la question : dans quel type de récit peut-on intégrer cela, et de quel appareil formel se servir ?

Les premiers films de Resnais, en ce sens, m’ont fasciné : la recherche de structures pour un contre-monde. Dans l’évolution de mon travail en tant que compositeur de films, je suis plus influencé par Resnais que par Godard, même si c’est Godard qui m’a procuré ce moment libérateur, contre tout académisme, et dont j’ai subi un tel impact d’exaltation que je n’en dormais plus. Enfin, il y avait la liberté de Godard, et la composition de Resnais : Hiroshima mon amour (1959), Muriel (1963), L’année dernière à Marienbad (1961), que je revois toujours avec émotion. D’un côté Hitchcock, de l’autre Leacock. En peinture, Mondrian et Pollock, ou Mondrian et Van Gogh : l’apollinien et le dionysiaque, je veux les deux, je suis toujours entre les deux. Mais, pour faire évoluer la structure d’un film, on a peut-être plus à apprendre chez Mondrian : Resnais, Hitchcock, Ozu surtout, sont du côté de Mondrian. Ozu, c’est très fort. Ses films sont comme des assemblages de points de vue plus ou moins fixes sur des éléments perpétuellement recyclés : la petite ruelle, les fils télégraphiques, les poteaux, les maisons cloisonnées par le bois ou le papier. Espaces fragmentaires et codés : des espaces vitaux nés du rapport entre les éléments spatiaux. Il se passe peu de chose, on dirait, et tout à coup c’est une émotion intense. Là, j’ai senti qu’on touchait à une essence du cinéma. Cela ne vient pas seulement des acteurs, malgré tout leur talent, leur émotion ; pas du récit non plus, dont le parcours est un peu toujours le même : la perte de quelqu’un, dont on finit par s’accommoder, selon une nécessité de la perte, même très dure. C’est finalement l’apprentissage de vivre, avec ce qu’il y a ou ce qu’il n’y a plus, qui passe parfois par des moments très douloureux, mais dans une grande tendresse. Le cadre est plutôt dur, dans un agencement de l’espace qui est à la fois physique et mental. Comme chez Hitchcock, c’est à la fois l’espace de l’action, celui du suspense de l’histoire, et un espace intérieur, mental. Chez Ozu, c’est fait avec retenue, humour, finesse. Dans Sanma no aji [Le goût du saké] (1962), il aborde la question de la modernité, qui croise celle de la perte. C’est le passage du saké au whisky. Lorsque j’ai eu le plaisir de séjourner brièvement au Japon, il y a quelques années, du train à grande vitesse, je regardais avec avidité le paysage urbain, reconnaissant les plans d’Ozu. La ruelle, les matelas mis à sécher, aux fenêtres de petites maisons. C’est un espace où se reconstitue la nourriture de notre regard. Mon travail par rapport au réel se situe dans ce double mouvement : un va-et-vient entre la fictionnalisation et le retour au monde. Un regard de reconnaissance sur le monde, au double sens du terme. Le mot reconnaissance s’applique très bien à Ozu.
![(3) Sanma no aji [An Autumn Afternoon] (Yasujirō Ozu, 1962)](/sites/default/files/inline-images/Ozu_Yasujiro%CC%82%201962%20Sanma%20no%20aji%20%5BAn%20Autumn%20Afternoon%5D_00019.jpg)
J’ai commencé à faire mes propres films avec une caméra que mes parents m’ont offerte quand j’ai quitté l’IDHEC, où je n’avais pas envie de rester jusqu’au diplôme. C’était une petite Bolex, qui permettait de tourner des plans de vingt-quatre secondes. Il fallait sans arrêt remonter le ressort. J’ai tourné avec elle tous mes premiers films, à partir de 1960. En 1965, j’ai obtenu une autre Bolex, avec de grands chargeurs, un moteur, et un générateur Pilotone, qui me permettait de tourner en synchrone. C’est ainsi que j’ai réalisé Beppie (1965, 38 mn). À partir de là, j’ai commencé à combiner des séquences en son synchrone et en son libre. Il faut penser qu’avant le développement du cinéma vérité, le cinéma documentaire c’était une image avec une musique, un bruitage ou un commentaire séparé, non synchrones. Avec le temps, le besoin s’est fait sentir d’avoir plus de couleurs sur la palette, et l’élément de synchronie des sons est devenu important.
Quand sont arrivés les films de Jean Rouch, Les maîtres fous (1955), et surtout Moi, un noir (1958), ce fut un autre choc. Tout à coup, l’idée d’une « syntaxe cinématographique », sur laquelle j’avais déjà beaucoup de doutes, a été balayée pour moi au profit d’une « syntaxe du corps » qui dictait l’enchaînement des images et des sons. Plus tard, ce fut surtout Eddie Sachs at Indianapolis (1961), de Leacock, Drew et Pennebaker, qui m’a impressionné. Le film tournait littéralement en rond pendant deux heures, en suivant les tours d’une course automobile. Ce cercle, c’était la forme graphique d’une scénographie puisée directement dans la contingence du réel.
J’avais donc deux Bolex, la petite, à ressort, avec laquelle je continuais à tourner beaucoup de plans, et cette Bolex bricolée, qui avait la manie de se coincer en milieu de bobine. J’ai intégré ce défaut dans Herman Slobbe – L’enfant aveugle II (1966, 29 mn), où la pellicule qui se coince devient une métaphore de la difficulté de faire du cinéma, et une invitation à capter les secousses du monde. L’alternance de ces deux caméras résume assez ma position dans le courant des années soixante : entre le langage du montage, qui avait dominé le documentaire d’avant-garde (et qui avait débouché sur une sorte de pictorialisme commenté), et le cinéma-vérité qui me fascinait par sa capacité d’épouser la durée des événements, mais qui manquait des moyens formels pour décrire « le monde des choses ». J’ai composé avec les deux, tout en faisant des incursions dans différents domaines narratifs ou expérimentaux.
À la fin des années soixante, j’ai acquis une Arriflex BL, une vraie caméra synchrone, assez lourde, mais avec laquelle j’ai quand même tourné jusqu’à la fin des années soixante-dix. Ensuite, j’ai hérité d’un peu d’argent, et j’ai pu échanger mon Arriflex contre une Aäton. Avec l’Arriflex, à cause du poids, je n’arrivais pas à faire certains mouvements, par exemple à me relever d’une position accroupie. Avec l’Aäton, le dynamisme est supérieur.

Entre-temps, il y a eu des films en 35 mm : Een film voor Lucebert [Un film pour Lucebert] (1967, 24 mn),2 De snelheid 40 –70 [La vélocité 40 – 70] (1970, 25 mn), et Beauty (1970, 25 mn). J’ai pu y explorer la couleur, des compositions aux cadres plus larges, plus de variété dans la profondeur de champ, et un son libre, détaché, que j’appliquais en couches, comme un peintre. Aujourd’hui encore j’ai le sentiment que c’est le travail du son qui rapproche le cinéma de la peinture.
J’ai toujours gardé ma Bolex pour des prises spéciales. Dans De platte jungle [La jungle plate] (1978, 90 mn), tout ce qui est de l’ordre du minuscule, je l’ai filmé avec la Bolex. Elle permet des manipulations intéressantes, que j’utilise encore dans certains de mes films : les changements d’objectifs, les surimpressions en rembobinant la pellicule dans la caméra, les ralentis ou les accélérés. Actuellement je la garde en copropriété avec un de mes fils (Stijn van Santen, fils d’un premier mariage de ma femme Noshka, qui vit avec moi depuis l’âge de trois ans), qui est devenu cinéaste. Avec cette Bolex, il a fait des choses, merveilleuses, très audacieuses, et cela m’a donné envie de la reprendre pour On Animal Locomotion. Lors d’un séminaire à Hambourg, avec Artavazd Pelechian, en février 1994, on s’est bien amusés avec ça : on a repensé certaines affaires de montage – mon propos avec Locomotion, où je me suis également souvenu du travail de Jonas Mekas. Grâce à Alf Bold, qui programmait le cinéma Arsenal à Berlin, jusqu’à sa mort, en 1993, j’ai pu voir Réminiscences of a Journey to Lithuania (1972). D’abord j’ai trouvé ça nul : cette image qui sautait… Mais Alf Bold m’a dit : « Il faut que tu considères ton jugement. C’est vraiment bien. » Je ne l’ai pas oublié. C’est justement ce tremblement quasi perpétuel de l’image qui la fait exister, entre liberté et incertitude.
J’ai parfois déclenché des tremblements dans mes films, comme un effet de ponctuation ou de réaction émotive. Par exemple, quand je filme Le Pen, j’ai envie de donner des coups de pied dans la caméra, de secouer l’image au rythme de ses invectives pleurnichardes. Certaines personnes trouvent cet effet trop gros dans Face Value, mais il correspond à un besoin irréfléchi que j’ai éprouvé pendant le tournage. Bon goût ou mauvais goût, c’est ma façon d’être impliqué dans le film. Un tremblement bien différent de celui de Marker dans Sans soleil (1983). Là, il y a comme une dissolution du cadre, une sorte de danse de l’image : enchaînement d’idées, de phrases, de jeux de mots, mais aussi des raccords de luminosité, de mouvement pur. Cet effet de flottement vient probablement de ce que Marker a tourné à la main, avec une caméra si légère qu’il ne pouvait pas la stabiliser, surtout avec une focale plutôt longue. Mais il a su en faire un avantage. C’est un grand travail musical, de musique de l’image. Cette façon de faire, j’y ai été sensible à travers Mekas. Tout cela circule. Et la Bolex s’y est retrouvée à l’ordre du jour.
Les artistes n’éprouvent pas de difficulté, en général pour dire que, dans le passé, ils ont été influencés par tel ou tel. Mais il est plus délicat de dire : aujourd’hui je suis sous influence. C’est plus délicat et plus subtil : les influences deviennent un moyen de se réactualiser, de rajeunir. Sans nier qu’on vieillit, on peut apprécier de participer d’un cinéma jeune. Il ne faut pas se crisper pour refaire les mêmes trucs qu’on a faits vingt ans avant. On est moins fort, physiquement, et il faut en tenir compte. Se regarder faire, faire évoluer ses acquis. Dans mon cas, c’est une évolution avec recyclage. Dans le passé, en cherchant à m’éloigner de l’étiquette « documentaire », j’ai cherché du côté du concept de « cinéma thématique ». Le cinéma que je faisais se situait quelque part entre documentaire et fiction, entre « vérité » et montage, entre filmage frontal et composition en angles obliques, et surtout il pouvait être vu comme un ensemble de relations dynamiques entre des images récurrentes susceptibles d’être considérées comme des thèmes, des sujets, dont on pouvait faire l’inventaire : les marchés (il y en a bien une dizaine dans les films de cette rétrospective), les mises à mort de bêtes, la viande crue, les fruits ; les fenêtres, les façades, les bornes qui marquent les limites d’un territoire ; les écoles, l’enseignement et l’apprentissage ; les portraits, les mains, le contact tactile avec les choses, les outils ; les pieds qui marchent, le contact avec le sol ; les yeux qui regardent l’œil de la caméra ; le blocage des yeux, les aveugles, le blocage des sens, les handicaps physiques, les corps qui se fatiguent dans un mouvement répétitif ; l’eau, le feu, la pierre, le métal, l’air et ses qualités lumineuses et tactiles ; le sommeil ; les écrans.
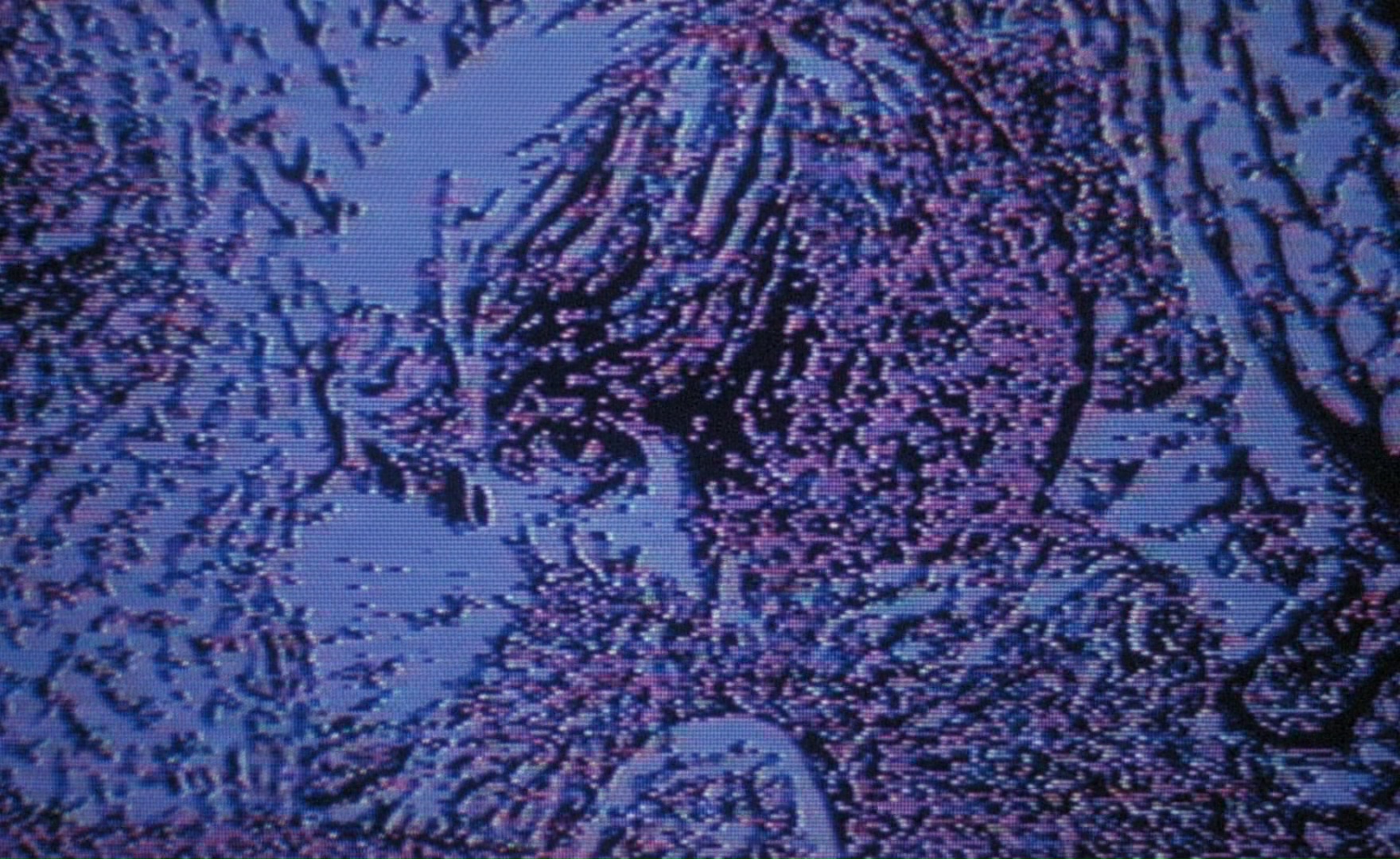
Il y a donc une mémoire des images enregistrées dans le passé qui fonctionne dans le présent. Avec les années, les films s’agglutinent entre eux. Mais malgré cette activité de mémoire, à chaque fois il faut retrouver la fraîcheur du « filmer pour la première fois ». On doit être disponible au « direct », c’est-à-dire au caractère unique et finalement incontrôlable de chaque situation, si on veut que le film puisse survivre au catalogue thématique. Donc ce concept de « cinéma thématique » est lui aussi trop contraignant. II est vrai qu’on dialogue avec les mêmes aspects de la vie. C’est ainsi qu’on « recycle », en devenant à la longue un peu plus exigeant sur la seconde prise : l’autre prise, l’autre mouvement, l’autre angle, à inventer. On consomme alors plus de pellicule. En tournant avec l’Aäton, le rapport entre la quantité de pellicule consommée et le film fini a évolué pour moi, avec les années, de 1/7 Jusqu’à 1/10, Avec On Animal Locomotion, je l’ai réduit à 1/5, à cause de la Bolex : avec la contrainte des plans très courts, on gaspille moins au filmage, et on augmente le temps de montage, tout en condensant le ton filmique.
C’est donc la spécificité des moyens qui détermine les chemins qu’on va prendre, vers des buts partiellement inconnus, et dans une articulation progressive du film. Le style n’est pas une caractéristique homogène, c’est un ensemble d’errances, peut-être de tics, au travers desquels la personne de l’auteur se tient tout juste cohérente. Le dernier moment d’unité avant l’effondrement, le dernier moment d’une « vision du monde », comme on disait autrefois : on recommence sans cesse la recherche de ce dernier moment.
Quoi qu’il en soit, je n’ai jamais été de ceux qui tournent d’abord une masse de plans pour ensuite assembler le film sur une table de montage. Ni non plus de ceux qui disent : « J’écris le film, je le monte, et je le monte en conséquence. » Pour moi, ce n’est ni l’un ni l’autre. Le montage commence par le visionnage de toutes les matières, qui permet déjà une évaluation des éléments tournés : « Ça, c’est bien, ça, c’est zéro », et une interprétation : « Là, j’étais à côté, j’ai voulu faire telle chose, mais ça n’est pas ça », ou bien : « Là, quelque chose surgit, beaucoup mieux ou plus important que ce qui était prévu. » Ensuite on doit trouver, ou retrouver, les liaisons, peu à peu : le programme caché qui est déjà inscrit dans les images filmées. Dans un cinéma largement improvisé comme le mien, les choses se programment de façon semi-consciente. Il y a naturellement une préméditation minimale des éléments nécessités au tournage et au montage, et des décisions immédiates, instinctives, dans un constant retour sur soi : se rappeler ce qu’on a déjà fait, ce qui s’est passé, et surtout qui on a été soi-même. Je veux dire, pas seulement une personne, mais plusieurs, avec des rapports variables à l’intérieur du moi, selon des conditions et des exigences différentes à chaque instant du tournage pour connaître la nature de ce qu’on a filmé, il importe de savoir qui on a été, et dans ce triangle en mouvement, les programmes et les schémas se dessinent, se définissent, ainsi que la direction et le sens du voyage.
L’important à mes yeux, dans deux films aussi différents que De tijd [Le temps] (1984, 45 mn) ou I Love Dollars (1986, 45 mn), c’est le voyage. Ce sont des films méthodiquement opposés. L’un repose sur l’artificialité : série de longs travellings dans un monde clos, où les gens et les choses ont été mis en place. L’autre se présente comme une traversée « en direct », pleine de rencontres et de confrontations imprévues, de quatre villes dans le monde. Mais tous les deux vont vers un petit quelque chose en vertu duquel à la fin, ce devra être un peu différent du début. Arriver à ce que, comme cinéaste et comme spectateur, le regard, ou le sentiment, ait été changé au cours du film, quelle que soit la longueur du voyage.
I Love Dollars peut être vu comme la quête d’une image composite et compacte du monde vu au travers du prisme de l’argent. Une quête dont le côté abstrait doit ressortir. Mais cette abstraction va quand même toucher la vie physique et mentale des gens, et la quête de l’abstrait devient la recherche d’une image qui est soudain vivante et importante. Le temps, c’est la même chose. À la fin de ces travellings sur ces espacés clos, on doit voir avec une liberté nouvelle ce qui se passe au-dehors. Les regards vers la caméra, ceux de l’actrice solitaire, eu ceux du gosse qui joue avec ses parents et fixe des yeux cette caméra qui tourne autour de lui, je les voulais innocents de fiction, pour qu’ils brisent le cercle. Mon désir, mon pari, était de revenir ici à quelque chose de très immédiat et de faire percevoir un moment vrai. I Love Dollars a quelque chose à voir avec une petite histoire érotique de ma jeunesse. J’avais douze ans et j’étais amoureux d’une fille de ma classe. Par le montage, je voulais établir une relation entre elle et ce monde de l’argent où le corps n’existe pas, est évacué, évaporé. Je voulais rapprocher ce souvenir de ma jeunesse avec celui de deux petites fontaines qui se trouvent à Amsterdam, près du monument du général van Heutz – une sorte de casseur colonial, un bourreau des Indes, au début du siècle –, établir, donc, une relation entre un monde personnel et une topographie de ma jeunesse : « Deux petites fontaines où un enfant pouvait boire. » Cette scène de ma jeunesse est émouvante pour moi, elle voyage au travers du film. Mais à chaque endroit où on la plaçait, elle devenait d’une complaisance insoutenable. Quand le cinéaste se met dans son propre film, il faut toujours se méfier. Il n’y avait plus aucune place pour cette scène, elle demandait presque un prolongement du film. Il y a aussi une scène où j’interpelle le directeur de la Banque de Hong Kong, et ou l’un sent que je ne suis pas du tout à la hauteur pour résister à la force et au pouvoir de ce gars-là. Il passe tout de suite à l’offensive, tandis que ma voix monte d’une octave, et j’ose à peine lui dire les choses dures et lui poser les questions gênantes que j’avais en tête. C’est un moment clé du film. La séquence est sur-montée : on y a mis trop de choses. L’image de la viande qu’on veut jeter à la figure du type, en essayant de l’impressionner avec la caméra, par un filmage en contre-plongée : mais lui ne bronche pas, il reste incroyablement fort. J’étais tellement abattu que cela faisait mieux passer, ensuite, et sans complaisance, la scène de jeunesse, et l’idée de la fragilité du personnage du cinéaste, qui a acquis sa dimension fictionnelle en se frottant avec le réel. Sa dimension « frictionnelle », si l’on veut.
Le film est un voyage à l’intérieur du voyage, dont beaucoup d’éléments voyagent à leur tour. Car le voyage, c’est aussi la mémoire : le regard vers l’inconnu de l’avant, vers l’arrière du chemin déjà parcouru. Ce qui m’intéresse au cinéma, ce n’est pas seulement la mémoire comme élément extérieur au film (comme dans Marienbad : « Est-ce que je ne vous ai pas déjà vu quelque part ? »), dans un univers fictionnel indépendant de lui, mais aussi la mémoire entre les plans du film et d’autres, semblables ou proches, par association. Mes films ont une consistance qui tient de la rétrospection. Il y a l’expérience immédiate de chaque image (il faudrait dire de chaque image-son), l’expérience de chaque transition entre deux images, et la formation de petites séries, de groupements, d’amalgames. Donc ce n’est qu’à la fin qu’on peut voir l’ensemble, comme un objet issu tout à coup d’un système de rapports temporels, s’immobilisant en objet condensé qui serait pour moi le moment de vérité, le moment documentaire pur, où cet objet composite existe par sa durée, à vivre et à voir, de façon pour ainsi dire visionnaire. Le document sur le réel, c’est peut-être cela. Non pas la réalité primaire de tous ces événements ou images, ni leur caractère fictionnalisé, mais la matérialisation finale de cet objet composite, dans notre tête.
![(6) Mer dare [Our Century] (Artavazd Pelechian, 1983)](/sites/default/files/inline-images/Pelechian_Artavazd%201983%20Mer%20dare%20%5BOur%20Century%5D_00002.jpeg)
Pelechian procède un peu de la même manière : activer la mémoire pour ramasser le tout, à un moment donné. Quand j’ai vu ses films, j’ai été très emballé, avec quelques réserves sur ses choix de musiques, dont on a d’ailleurs discuté, lors de ce séminaire à Hambourg dont j’ai déjà parlé. J’avais lu que Pelechian, c’était le « montage à distance » : or c’est justement ce que je fais, moi, depuis longtemps. Et lui, a fortiori, puisqu’on a vu ses films avec vingt ans de retard. Les choses peuvent surgir de façon simultanée, c’est bien connu. Mais je crois qu’il y a quelques différences entre lui et moi. Chez Pelechian, il y a des tonalités cosmiques, une recherche concernant des lois immuables du Cosmos. II en donne un exemple que je trouve saisissant : il a posé deux boîtes d’allumettes, à une certaine distance, et il prétend à cette sorte de pari, dans l’absolu, que s’il fait bouger l’une des deux boîtes, l’autre se met aussi à bouger, comme si l’univers était dirigé par une force immatérielle, ou sub-matérielle. Le pari porte sur rien de moins que sur une loi qui régirait l’univers entier. C’est une pensée qui va de la matière vers la magie. Tandis qu’en ce qui me concerne, il s’agit plutôt de petite magie : sans doute il y a de l’incroyable, et le monde est plus magique qu’on ne le pense, plus riche en possibilités que la petite partie de lui qui nous est révélée.
Pelechian propose l’idée d’une mise en rapport de gros blocs d’images (le plus beau film que j’ai vu à cet égard, c’est Mer dare [Notre siècle] (1983), où il est justement question de l’espace et des cosmonautes), avec des blocs entiers de sons. De grands ensembles d’images combinés avec des ensembles sonores. Comme si le réel était constitué de blocs, sujets à ré-éditions. Ce qui est très fort, parce que cela induit l’idée d’un questionnement de tout déjà-vu. Mais chez Pelechian, il n’y a pas de rapports conflictuels entre ces blocs d’images, tandis que chez moi il y en a beaucoup. Dans mes films, le mouvement doit échapper à la rigueur des cadres pour rejoindre d’autres mouvements, par un système de lignes de fuite, et pour devenir, éventuellement un mouvement généralisé, mais non obligé. Tandis que chez Pelechian il y a une primauté du mouvement : il prend tout, rien ne lui résiste. Nous n’avons pas non plus la même conception du cadre : le mien cherche à imposer sa rigueur, ou son équilibre, à tout ce qui ne bouge pas, mais ne se trouve pas non plus en repos. Il s’agit donc d’un équilibre éphémère, et d’une rigueur que la nervosité menace. Alors que chez Pelechian le cadre n’est perçu qu’en tant qu’état possible du mouvement, lequel possible se suffit à lui-même tant une force lyrique y est à l’œuvre.
Au fond, ma recherche concerne tous les rapports possibles entre les images et les sons. Les images entre elles, les groupes d’images, peuvent être affectés par la plus grande proximité, ou par l’extrême de la distance, ou même voyager de film en film, selon un mouvement cyclique. Chaque plan d’un film peut rencontrer chaque plan d’un autre film. En fait de hiérarchie, aucune ne préexiste à celle qui s’établit à la fois dans le processus de fabrication d’un film, et dans l’acte de son déroulement devant le spectateur. Toutes les assonances, tous les rythmes sont possibles, toutes les harmonies, tous les conflits. Les conflits sont très importants pour moi parce qu’ils sont la preuve que l’expérience du réel n’est jamais définitive. Je reste un cinéaste matérialiste : le monde existe en dehors de nous, et notre rêve se heurte à lui. Le travail du cinéma, c’est cette relation entre les deux : work in progress, toujours.

- 1L’album Paris mortel a été publié en 1963.
- 2Lucebert (1924-1994) est l’un des plus grands poètes de la littérature hollandaise du XXe siècle. En 1948 il a rejoint le Groupe expérimental de Hollande, puis le mouvement international Cobra. Le langage de Lucebert est visionnaire, bien qu’il repose entièrement sur l’aspect matériel des mots. Il crée l’image du voyant qui regarde un monde au bord de l’abîme et continue à rire. À partir de 1960, Lucebert s’est fait connaître comme peintre, avec une énorme production picturale. J’ai fait trois films sur lui : Lucebert, dichter-schilder [Lucebert, poète-peintre] (1962), Een film voor Lucebert [Un film pour Lucebert] (1967), et Als je weet waar ik ben zoek me dan [Si tu sais où je suis, cherche-moi], entièrement tourné dans son atelier, qui est resté en l’état, après sa mort en plein travail. Ce dernier film, tourné en mai 1994, je l’ai monté avec les deux précédents pour en faire un triptyque, Lucebert, tijd en afscheid [Lucebert, temps et adieux] (1994), qui couvre donc une période de trente-deux ans, et que j’espère présenter à Paris en mars 1995.
Ce texte a été publié à l’origine dans Trafic n° 13, hiver 1995, 14-23.
Image (1) de Marnie (Alfred Hitchcock, 1964)
Image (2) de Muriel ou le temps d'un retour (Alain Resnais, 1963)
Image (3) de Sanma no aji [An Autumn Afternoon] (Yasujirô Ozu, 1962)
Image (4) de Moi, un noir (Jean Rouch, 1958)
Image (5) de Sans soleil (Chris Marker, 1983)
Image (6) de Mer dare [Our Century] (Artavazd Pelechian, 1983)
Image (7) de Amsterdam Global Village (Johan van der Keuken, 1996)

